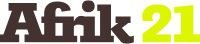Suite aux révélations alarmantes de l'Oakland Institute sur les abus perpétrés dans le cadre du projet d'extension du parc national de Ruaha en Tanzanie, la Banque mondiale a annoncé la suspension d'un financement de 150 millions de dollars. Dans un entretien exclusif avec Anuradha Mittal, Directrice exécutive de The Oakland Institute, Afrik21 plonge au cœur des enjeux de conservation de la biodiversité en Tanzanie. La responsable révèle les défis majeurs auxquels sont confrontées les communautés autochtones, ainsi que les lacunes de la Banque mondiale dans sa réponse aux violations des droits humains.
Afrik21 : Pouvez-vous nous donner un aperçu de la situation actuelle en Tanzanie concernant la conservation de la biodiversité et les droits des peuples autochtones ?
Anuradha Mittal : Le gouvernement tanzanien étend les zones « protégées » pour renforcer les activités des sociétés de safari et de chasse au trophée dans le but d’attirer cinq millions de touristes et de générer 6 milliards de dollars de revenus annuels dans le secteur d’ici à 2025. Confrontées à des expulsions forcées, à de graves violations des droits de l’homme et à des restrictions de moyens de subsistance, ce sont les communautés autochtones et locales qui supportent le coût de cette expansion et qui sont chassées de leurs terres ancestrales. Ces efforts ne visent pas à préserver la biodiversité ou à protéger l’environnement, mais sont promus uniquement pour augmenter les revenus du tourisme.
Quels sont les principaux objectifs de votre organisation concernant ces problèmes en Tanzanie et dans d’autres parties de l’Afrique ?
L’Institut d’Oakland répond aux demandes des communautés touchées dont les droits à la terre et à la vie sont menacés. En Tanzanie, depuis plusieurs années, nous soutenons les luttes des communautés maasaï de Loliondo et de la zone de conservation de Ngorongoro (NCA), ainsi que des petits agriculteurs et des pasteurs vivant près du parc national de Ruaha. Dans chaque cas, ces communautés sont confrontées à des violations des droits de l’Homme, à des expulsions et à des restrictions de moyens de subsistance sous prétexte de « protéger » l’environnement. Malgré avoir préservé la terre pour préserver la biodiversité et assurer la santé des écosystèmes, les communautés autochtones font face à la faim, à la pauvreté, à la perte des moyens de subsistance, au déplacement et à la violence. Nous œuvrons pour que le gouvernement respecte ses obligations légales – consacrées dans les lois nationales et les normes internationales des droits de l’homme – et que les droits de ces communautés soient respectés.
Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées ces communautés en raison de ces projets de conservation ?
Les projets de « conservation » en Tanzanie dévastent les communautés autochtones à travers le pays. En octobre 2023, le gouvernement a annoncé qu’il étendait les limites du parc national de Ruaha. Les nouvelles limites engloberont désormais au moins 23 villages légalement enregistrés – forçant l’expulsion de plus de 21 000 personnes qui n’ont pas donné leur consentement libre, préalable et éclairé à la décision et qui n’ont pas été indemnisées ou n’ont pas reçu de terres alternatives. Des milliers de personnes supplémentaires vivant dans des sous-villages sont désormais considérées comme faisant partie de la zone du parc national de Ruaha et seront également expulsées.
L’électricité a été coupée dans de nombreux villages, les maisons ont été marquées pour la démolition et les enfants ont cessé de fréquenter des écoles qui ont désespérément besoin de réparations. Ces communautés sont confrontées à des restrictions de moyens de subsistance paralysantes – limitant les zones où le bétail peut paître et où les cultures peuvent être plantées – qui alimentent la pauvreté et la faim. Les rangers paramilitaires du parc national de Tanzanie (TANAPA) patrouillent dans les villages légalement enregistrés, saisissant le bétail par milliers sous le faux prétexte qu’il se trouve dans le parc et les mettant aux enchères. Ces saisies ont financièrement ruiné d’innombrables familles. Les tentatives des villageois pour protéger leur bétail ou leur équipement agricole ont régulièrement été accueillies par une force écrasante des rangers du TANAPA. De nombreux meurtres, viols et passages à tabac perpétrés par ces rangers sont bien documentés. Les villageois vivent dans la peur et leur vie reste en suspens en raison de l’expansion du parc.
Ces abus et expulsions ne se limitent pas au parc national de Ruaha, mais se produisent dans tout le pays. Pour plus d’informations, voir :
https://www.oaklandinstitute.org/urgent-alert-tanzanian-government-rampage-against-indigenous-people
https://www.oaklandinstitute.org/tanzania-sustained-campaign-maasai-loliondo-ngorongoro-conservation-area
Quel rôle les institutions internationales, telles que la Banque mondiale, devraient-elles jouer dans la promotion de la conservation de la biodiversité tout en respectant les droits des peuples autochtones ?
La Banque mondiale ne devrait pas financer un projet visant à promouvoir le tourisme en Tanzanie – un pays notoire pour avoir régulièrement piétiné les droits fonciers des autochtones. La longue histoire des expulsions illégales et des abus pour créer des parcs en Tanzanie a été bien documentée au fil des ans et aurait dû être connue de la Banque avant de s’associer au gouvernement et de fournir des centaines de millions de dollars.
Comment évalueriez-vous la réponse de la Banque mondiale aux violations des droits de l’Homme documentées dans le projet REGROW en Tanzanie ?
La suspension du financement du projet REGROW était depuis longtemps nécessaire. Le projet a été lancé en 2017 et la Banque a omis de faire preuve de diligence raisonnable. Lorsqu’elle a été informée que le gouvernement tanzanien ignorait complètement les propres garanties de la Banque, celle-ci a rejeté la responsabilité et ignoré des preuves accablantes pendant une année entière. En réponse à notre lettre initiale envoyée en avril 2023, la Banque a nié tout acte répréhensible et n’a pas pris de mesures pour mettre fin aux violations des droits de l’homme et aux expulsions qu’elle finançait directement. L’Institut a ensuite déposé une demande d’inspection auprès du panel d’inspection indépendant de la Banque en juin 2023 au nom des villageois du district de Mbarali. En novembre 2023, le conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé la recommandation du panel d’inspection de lancer une enquête axée sur les actions des rangers du TANAPA. L’enquête est en cours et se conclura avant fin 2024.
Malgré les appels répétés des villageois touchés pour geler le financement du projet depuis avril 2023, des millions de dollars ont continué à être versés par la Banque. Au moins 125 millions de dollars sur les 150 millions de dollars du budget total ont été versés avant la suspension, dont 60 millions de dollars depuis le dépôt de la plainte en juin 2023. En plus de permettre à des plans d’expulsion de se poursuivre, le manque de réaction immédiate de la Banque a entraîné de graves préjudices pour les communautés locales. Les versements continus du projet ont permis au TANAPA de continuer à commettre des meurtres et des saisies de bétail ces derniers mois.
Les procédures de la Banque pour le dépôt de plaintes sont excessivement bureaucratiques, nécessitant des quantités massives de temps et de ressources que les communautés locales n’ont pas. Il subsiste un déséquilibre énorme de pouvoir entre les villageois touchés par ce projet et les décideurs de la Banque mondiale. Cela devrait être un appel au réveil pour les dirigeants de la Banque à Washington, D.C. – vous ne pouvez pas continuer à ignorer les voix du peuple sur le terrain qui lutte pour survivre en raison de vos prétendus projets de « développement ».
Quelles mesures spécifiques les gouvernements et les organisations internationales ont-ils prises pour remédier à ces violations ?
La condamnation internationale n’a jusqu’à présent pas réussi à arrêter les abus continuels du gouvernement. Les pays donateurs n’ont pas conditionné leur soutien aux efforts de développement touristique de la Tanzanie au respect des droits de l’homme. Les États-Unis sont le plus grand donateur bilatéral de la Tanzanie et ont joué un rôle déterminant dans la conception de la stratégie agressive du pays pour étendre l’industrie touristique aux dépens des communautés autochtones. Malgré les avertissements répétés, les États-Unis n’ont pas pris de mesures significatives pour remédier à leur rôle dans ces abus. Le rapport de l’Institut d’Oakland, « Retirer le rideau : Comment les États-Unis poussent la guerre de la Tanzanie contre les Autochtones », fournit plus de détails et est disponible ici: https://www.oaklandinstitute.org/pulling-back-the-curtain
Comment envisagez-vous l’avenir de la conservation de la biodiversité en Tanzanie et dans d’autres parties de l’Afrique, en tenant compte des défis actuels ?
À une époque où les actions humaines menacent plus d’un million d’espèces d’extinction mondiale – un nombre plus grand que jamais auparavant – des mesures doivent être prises pour réduire la perte de biodiversité. Cependant, les efforts actuels visant à étendre les zones protégées au détriment des peuples autochtones représentent une voie dangereuse. En décembre 2022, le Cadre mondial pour la biodiversité (GBF) de Kunming-Montréal a été adopté lors de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15). Un objectif majeur du GBF est de placer 30 % de la planète dans des zones protégées d’ici à 2030. Bien que le Cadre contienne des dispositions reconnaissant les droits des peuples autochtones, il ne va pas assez loin et risque de devenir la plus grande appropriation de terres de l’histoire. Cette crainte est légitimée par des études montrant que l’atteinte de l’objectif de 30×30 pourrait directement déplacer et déposséder 300 millions de personnes.
Englobant 22 % de la surface terrestre mondiale, les territoires traditionnels des peuples autochtones coïncident avec des zones qui abritent 80 % de la biodiversité de la planète, démontrant ainsi que les peuples autochtones assurent une conservation efficace et durable. Pour protéger la biodiversité, la colonisation des terres autochtones au nom de la conservation doit prendre fin.
Propos recueillis par Boris Ngounou